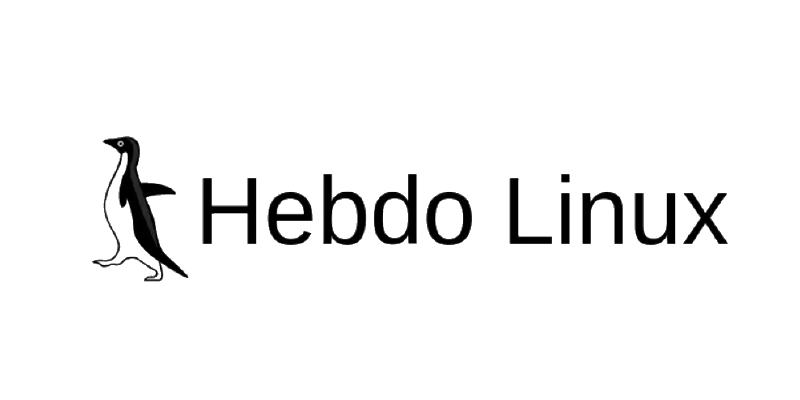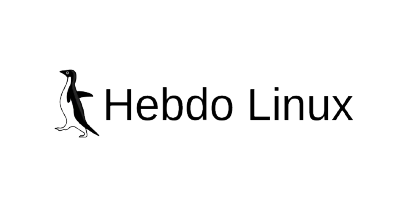En 2023, plus de 70 % des entreprises mondiales auraient utilisé au moins une plateforme no code ou low code pour développer des applications internes. Les solutions qui permettaient autrefois de contourner le manque de ressources en programmation deviennent un levier stratégique, au point d’attirer l’attention des directions générales.
Le fossé se creuse entre la promesse de vitesse offerte par ces outils et les impératifs toujours plus élevés en matière de sécurité, d’intégration, et de personnalisation. Beaucoup d’entreprises découvrent que l’accessibilité ne fait pas tout : des défis techniques et organisationnels surgissent dès que l’on gratte la surface. Les pratiques s’adaptent, tout comme les attentes envers les métiers du développement.
Low-code et no-code : comprendre les fondamentaux et leurs différences
Le no code bouleverse le développement logiciel. Grâce à des interfaces graphiques accessibles, il met la création d’applications à la portée de profils sans expertise technique. Propulsé par des plateformes comme Webflow, Bubble, Weweb, Flutterflow ou Ksaar, ce mouvement fait émerger de nouveaux acteurs : les citizen developers.
En parallèle, le low code s’affirme comme une voie hybride. Il conjugue la simplicité du no code avec la possibilité d’ajouter du code personnalisé, répondant ainsi à des besoins plus poussés. Sur ces plateformes, le développeur web se concentre sur les modules complexes, pendant que les équipes métiers gagnent en autonomie sur les prototypes et l’automatisation.
Il est utile de distinguer ce que chaque approche permet réellement :
- Le no code : privilégie la rapidité, la simplicité et l’accès à l’innovation pour tous.
- Le low code : mise sur la personnalisation, l’intégration avancée, et la compatibilité avec des systèmes existants.
La séparation entre ces deux mondes reste ténue. Une plateforme no code peut rapidement montrer ses limites dès qu’il s’agit de concevoir des interfaces élaborées ou de connecter des outils spécifiques. À ce stade, les solutions low code prennent le relais, dessinant un paysage où la collaboration entre profils techniques et métiers devient un moteur d’innovation.
Quels impacts sur le développement web et les métiers du numérique ?
L’adoption du no code et du low code transforme la répartition des rôles dans la tech. Des startups aux multinationales, les organisations s’appuient sur ces outils pour dynamiser leur transformation digitale et maîtriser leurs budgets. Le phénomène du citizen developer prend de l’ampleur : des professionnels sans bagage informatique avancé créent leurs propres applications, automatisent des process, et pallient le manque chronique de développeurs qualifiés.
Voici comment différents types d’acteurs s’approprient le no code :
- Les startups lancent des MVP à coût réduit et testent rapidement leurs idées.
- Les PME élaborent des outils sur-mesure pour gagner en efficacité.
- Les grands groupes accélèrent la modernisation de leurs processus métiers grâce au prototypage rapide et à l’automatisation.
Les écoles du numérique, comme l’EFREI, ajustent leur enseignement pour former à ces nouveaux outils. Les cursus évoluent, préparant une génération capable de jongler entre logique métier et développement d’applications.
Le métier de développeur web se transforme radicalement : la création d’outils numériques n’est plus son domaine réservé. Désormais, la spécialisation prend le pas : intégration poussée, sécurité (DevSecOps), maintenance. Les équipes DevOps associent développement, exploitation et automatisation, et la sécurité s’ancre dès la conception des projets.
Cette convergence des compétences ouvre la voie à de nouveaux parcours professionnels et rebat les cartes en matière de formation numérique, de gestion de projet, et d’organisation du travail digital.
Des opportunités inédites pour les entreprises et les créateurs
Le no code devient un accélérateur pour les organisations en quête d’agilité et de réactivité. Il suffit de quelques manipulations pour intégrer des services comme Make, N8N, Stripe ou Algolia et transformer la gestion de l’automatisation. L’arrivée de l’intelligence artificielle (IA) dans ces plateformes élargit encore les possibilités : génération de contenu, automatisation de tâches, tout cela sans recourir à des équipes techniques surdimensionnées.
Des exemples concrets illustrent cette dynamique. Comet.co s’est appuyé sur le no code à ses débuts avant d’évoluer vers une solution plus traditionnelle. TaskRabbit, sous l’impulsion de Leah Solivan, a prouvé qu’une approche pragmatique pouvait soutenir la croissance d’un service à la demande. D’autres acteurs, comme le cabinet theTribe, misent sur le no code pour donner vie à des projets variés : L’Avenir en Main (Bubble), Social Fibre (Ksaar), ou encore Je Cherche un Chauffeur (Webflow).
Voici quelques situations où le no code s’impose comme une solution concrète :
- Les PME digitalisent rapidement leurs processus internes.
- Les startups confirment leur modèle avec des MVP peu coûteux.
- Les indépendants et créateurs lancent des plateformes sans dépendre d’équipes externes.
L’essor de solutions comme Bubble, Weweb, Flutterflow ou Ksaar élargit l’arsenal à disposition pour transformer une idée en application. Ces outils se perfectionnent, intègrent l’IA, et ouvrent la voie à des architectures flexibles, où le low code complète l’approche visuelle pour s’adapter aux besoins les plus spécifiques.
Tendances à suivre et défis à relever pour l’avenir du no code
Le no code poursuit son évolution et suscite l’intérêt non seulement des directions métiers mais aussi des DSI, qui voient poindre de nouveaux enjeux : personnalisation, sécurité, conformité. L’intégration directe du RGPD et la souveraineté des données deviennent des critères décisifs dans le choix des plateformes, soumises à la pression réglementaire européenne. Mais les applications créées sans code restent tributaires de la plateforme choisie, licences, évolutivité, portabilité des données : autant de points à examiner avec attention.
Le développement de solutions open source dans l’écosystème no code vient bousculer la donne. Ces alternatives ouvertes offrent davantage de contrôle sur l’infrastructure et limitent le risque de dépendance technologique. La demande de tierce maintenance applicative (TMA) explose : accompagner, migrer, maintenir et auditer les projets no code devient un secteur à part entière, mobilisant développeurs, experts métiers et spécialistes de la conformité.
Dans le même temps, la distinction entre no code et low code s’estompe, donnant naissance à des architectures hybrides où interface graphique et personnalisation avancée cohabitent. Cette modularité permet d’innover vite, sans sacrifier la capacité à répondre à des besoins pointus. Le développement traditionnel conserve son intérêt pour certains usages sensibles, mais la dynamique actuelle invite à redéfinir la place de chacun, du développeur à la gouvernance numérique.
Le no code n’a pas fini de surprendre : il s’infiltre partout, transforme les méthodes, et redessine les frontières entre métiers. La prochaine grande innovation pourrait bien venir d’un profil inattendu, armé d’une plateforme visuelle et d’une bonne dose d’audace.